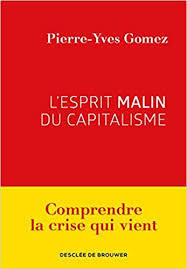Pierre-Yves Gomez, L’esprit malin du capitalisme, Paris, Desclée De Brouwer, 2019
Une enquête sur les promesses qui fondent la mentalité spéculative
Depuis longtemps la plupart des professionnels du marché ont repéré le rôle central des promesses faites aux clients et des croyances et convictions qui pourraient, devraient, s’ensuivre. Ils sont notamment familiers de la notion de positionnement et, surtout, de celle de proposition de valeur. Cette déclaration, aussi concise et claire que possible, qui énonce et réitère la promesse que l’offre de l’entreprise est dotée d’une valeur supérieure à celle des concurrents. Il s’ensuit que le client potentiel pourrait, devrait, en être convaincu (si toutes les actions de l’entreprise sont capables de confirmer cette promesse) et qu’ainsi un tel fournisseur, une telle marque, pourrait, devrait, disposer d’un avantage concurrentiel radical. L’esprit malin du capitalisme (Desclée de Brouwer, 2019), le dernier ouvrage de Pierre-Yves Gomez, généralise cette idée et nous livre une enquête minutieuse et documentée sur la construction d’un récit qui nous concerne tous.
Cette enquête concerne l’émergence, la diffusion et le triomphe de ce qu’il appelle le capitalisme spéculatif. Cette manière particulière de rationaliser la valeur et de définir la performance qui s’est imposée en un demi-siècle dans de multiples pratiques et sur toute la planète. L’enquête sur ce récit est précédée d’un prologue et suivie d’un épilogue où l’auteur se transforme en essayiste et nous livre son sentiment et ses espoirs. Le lecteur paresseux et pressé qui se contenterait de lire l’introduction et la conclusion “pour se faire une idée” passerait largement à coté d’une approche minutieuse et documentée.
Comment a émergé et s’est diffusé ce nouvel esprit néfaste et rusé, donc malin ? Comme dans son précédent ouvrage (Le Travail invisible, 2013), Gomez propose d’abord une analyse du processus de financiarisation de l’économie. La loi de 1974, qui visait à réformer les caisses de retraites aux États-Unis, lui sert de point de départ. L’une de ses conséquences fut d’orienter progressivement l’épargne des ménages vers les marchés boursiers. Pas seulement l’épargne des retraités d’Amérique du nord, mais celle de tous les épargnants de la planète. Dès lors, une énorme masse de liquidités se met en quête de promesses de rentabilité. Une dizaine de grandes places financières au service d’un millier d’entreprises géantes animent ce processus. Tandis que, de proche en proche, toute l’activité économique mondiale s’est alignée sur les principes de la spéculation financière. Apparaît ainsi le « casino » global qui fait rêver épargnants et investisseurs.
La financiarisation de l’économie a eu pour effet de transformer la plupart des entreprises et des organisations en une abstraction chiffrée que Gomez appelle « l’entreprise-tableur ». Celle qui multiplie les systèmes d’information et les instruments d’évaluation de la performance (taux, ratios, indices, classements, etc.). Celle qui enseigne à chacun, du haut en bas de l’échelle, que pour ne pas disparaître il faut s’adapter aux impératifs de l’information en temps réel. Qu’il faut alimenter, suivre et respecter les multiples indicateurs qui permettent de rationaliser finement le pilotage des organisations et donc l’activité de tous les travailleurs : tableaux de bord, instruments de contrôle, performances et normes affichées sur des écrans, reportings incessants, etc. Au nom de l’intérêt supérieur des épargnants (retraités ou non) et pour sécuriser leurs placements, il faut bien en passer par là.
Le triomphe du capitalisme spéculatif ne s’arrête, hélas, pas là. Gomez va ainsi au delà de son précédent ouvrage pour montrer que ce cadrage très convaincant structure désormais de multiples activités ordinaires. Celles, évidemment, des dirigeants d’entreprises, des technocrates et des bureaucrates de l’évaluation ainsi que celles des travailleurs évalués en permanence. Mais, beaucoup plus largement, les pratiques des professionnels du marché, des clients, et de tous les acteurs qui s’agitent dans les réseaux « dits » sociaux. Tous sont devenus sensibles à la fièvre spéculative. Les mêmes dispositifs (ordinateurs, téléphones, tablettes, etc.), utilisés dans les activités professionnelles comme dans les activités domestiques, sont capables de nous transformer en microcapitalistes éblouis par les promesses et les opportunités évoquées dans les plateformes du monde digital.
Sans cesse, nous guettons les promesses du futur. La promesse du cours élevé de nos quelques actions ; la promesse d’un prix de revente supérieur de l’appartement acheté pourtant bien cher ; la promesse de futurs revenus en provenance de la location d’une chambre d’amis ; la promesse d’un voyage moins onéreux, et peut-être plus convivial, grâce au covoiturage ; la promesse d’une future baisse de prix d’un nouvel appareil ; la promesse de futurs soldes, etc. Nous pouvons spéculer obstinément sur l’état futur de la valeur des choses et même, via le développement personnel, sur la valeur de notre propre « capital humain ». Que nous le voulions ou non, nous sommes tous devenus de petits acteurs du capitalisme spéculatif, attentifs aux multiples indicateurs de performances. Nous suivons, en cela, les pratiques des gros spéculateurs qui s’efforcent, en permanence, d’identifier des « relais de croissance », de repérer de nouvelles « pépites » parmi les start-up, de flairer de nouveaux « gisements de valeur », de miser sur les « synergies » et les « disruptions » à venir.
Gros et petits spéculateurs partagent ce même esprit, cette même mentalité, et cette même confiance dans les instruments qui semblent prédire l’avenir de nos futurs gains. Cette même idéologie de la rente qui nous épargne les soucis du présent en regard d’un futur radieux. L’historiographie contemporaine demeure suspicieuse vis-à-vis de la notion de mentalité, mais cette dernière a l’avantage de mettre clairement en évidence la banalisation d’une idéologie, en l’occurrence celle de la spéculation, dans toute une population planétaire. L’espoir que les dépenses du présent, nos dépenses, seront rendues insignifiantes par la richesse espérée dans le futur. La conviction qu’un tel désir de gain va très probablement se réaliser si nos experts dans les placements (ceux qui gèrent notre épargne et notre « assurance vie ») demeurent bien informés et compétents.
Gomez n’a cependant pas la naïveté de croire que nous devons cette situation la seule puissance du vaste discours de la « science » économique ou de celui du néolibéralisme, son avatar contemporain. Sans doute leurs idées ont alimenté le cadre conceptuel qui fonde nombre de nos institutions. En cela, elles ont grandement facilité la construction et l’affirmation du cadrage spéculatif. Mais ce dernier ne s’est déployé et diffusé que grâce au soutien et à l’action de ce que Michel Callon appelle des agencements socio-techniques. Toute activité ne se développe pas, en effet, indépendamment de l’agencement de dispositifs matériels et des compétences qui leur sont associés. Notamment, l’agencement que Gomez appelle la « technocratie spéculative ». Des acteurs très concrets et des outils très matériels, depuis les petites mains qui nourrissent les tableurs, jusqu’à l’élite qui, le nez sur les tableaux de bord, définit les stratégies de placement, en passant par toute la bureaucratie qui gère et ordonne de multiples instruments de mesure et de contrôle.
Mieux, la communauté des usagers des plateformes, c’est-à-dire vous et moi, est sommée d’évaluer sans cesse la réputation de chacun afin d’apprécier la pertinence de toute promesse. Celle des vendeurs, des fournisseurs, des loueurs, des acheteurs, des clients ou des locataires. Celle des marques, des enseignes, des lieux de loisirs ou des établissements d’enseignement et de soins. Nous devenons tous, progressivement, les auteurs et usagers de multiples systèmes d’information. Au total, bon gré ou mal gré, de près ou de loin, nous devons tous nous ajuster aux multiples promesses et évaluations fournies par le capitalisme spéculatif.
Dès lors, la plate dénonciation du « système » ne suffit pas. Les arcanes de la pensée économique auront, sans doute, joué leur rôle performatif. Les dévots du marché sont bien présents et actifs, mais ils n’ont pas fomenté un complot quelconque. La simple déploration du cauchemar de la marchandise et d’une éventuelle pathologie nommée hyperconsommation ne remet pas fondamentalement en cause le récit du capitalisme spéculatif. Il s’agit d’abord de comprendre comment il fonctionne et comment nous y contribuons. S’il suscite la conviction du plus grand nombre, c’est parce que cette mentalité est largement partagée et, surtout, inscrite dans des dispositifs matériels quotidiens très concrets. Des dispositifs utilisés, animés et mobilisés par tous les spéculateurs, les gros comme les petits.
Peut-on, faut-il, dépasser un tel récit et sortir de cette situation ? Peut-on, faut-il, extraire nos contemporains de cette mentalité ? Peut-on, faut-il, supprimer ou limiter l’usage de leurs instruments favoris ? Je laisse au lecteur le soin de lire l’épilogue proposé par Gomez, lorsqu’il se penche sur le vécu de l’expérience de chacun.
Gilles Marion
Professeur émérite
EM LYON Business School
Janvier 2020